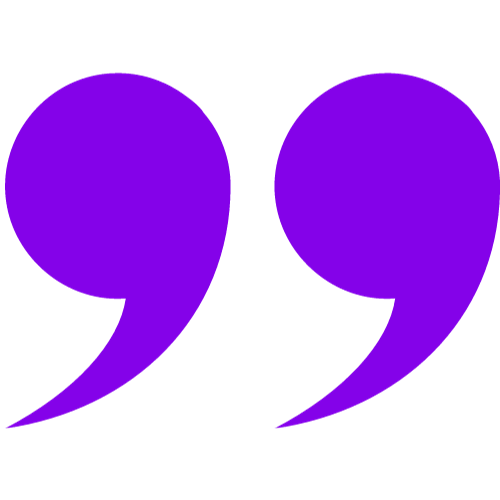Pf. Olivier de Frouville
Professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon-AssasAccueil »
Olivier de Frouville est professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas, directeur du Centre de recherche sur les droits de l’homme (CRDH) et membre de l’Institut Universitaire de France. Spécialiste du droit international et des droits de l’Homme, il a siégé dans plusieurs instances des Nations Unies, notamment sur les disparitions forcées, et consacre ses travaux à la protection internationale des droits fondamentaux et à la théorie du droit.
Le Professeur de Frouville a mené une présentation sur les fondements juridiques sur lesquels les auteurs de crimes contre les personnes LGBT+ pourraient être jugés, sur la base de l’article 7 du Statut de Rome.

English
On what grounds should state agents be prosecuted?
I have been asked to address the criminalisation of homosexuality within the framework of crimes against humanity. Before proceeding, I would like to echo the statements made at the opening of the conference by Ambassador Berton and the President of Amnesty International. We are currently facing a particularly challenging period, marked by the rise of anti-rights movements. However, I concur that this is not the moment to retreat from the defence of human rights; rather, it is a time to renew our efforts and strengthen our unity. All those committed to fundamental rights and inclusive societies should act collectively to counter anti-rights movements and reaffirm the values of universality and human rights, which are foundational pillars of the post-war international order. The construction of peace and equality depends on this collective commitment.
Turning to my presentation, I wish to clarify my approach to the concept of the criminalisation of homosexuality. I propose to understand both terms— »criminalisation » and « homosexuality »—in a broad and contextual manner, informed by the realities of sexuality, sexual identities, and sexual characteristics. The terminology varies according to context; some refer simply to « homosexuals », while others prefer LGBT, LGBTQI, or LGBTQI+, with the latter being more inclusive. What unites all those concerned is the experience of discriminatory criminalisation based on sexual orientation, gender identity or expression, or sexual characteristics. This point has been emphasised in reports of the United Nations Special Rapporteur on sexual orientation and gender identity, which state: “at the root of the acts of violence and discrimination under examination lies the intent to punish based on preconceived notions of what the victim’s sexual orientation or gender identity should be, with a binary understanding of what constitutes a male and a female or the masculine and the feminine, or with stereotypes of gender sexuality.”
Within the framework of this conference, the term « homosexuality » should thus be understood as encompassing all those targeted under such preconceived gender notions and consequently subject to criminalisation. It is equally important to adopt a broad understanding of criminalisation itself. On one level, criminalisation refers to legislative and regulatory provisions that explicitly or implicitly criminalise homosexuality or other non-conforming gender identities or expressions. Such laws, by their mere existence, have a chilling effect and constitute discrimination in violation of international human rights instruments.
However, it also often refers to the enforcement of these laws, and the measures taken pursuant to them—such as arbitrary detention, imprisonment, or, in some jurisdictions, the death penalty—that further compound the harm. There are instances where laws are not systematically enforced, but their presence enables or justifies discriminatory practices. Uganda is a telling example: while the law prohibiting homosexuality and providing for the death penalty is not always enforced, its existence fosters discrimination and shapes societal attitudes. Beyond the law, or even absent a clear legal basis, there may be de facto criminalisation of homosexual conduct, or the use of other legal provisions to target individuals for reasons that are, in reality, rooted in their sexual orientation or gender identity.
It is therefore essential to approach the notion of criminalisation from a broad perspective. Criminalisation does not concern only acts perpetrated by State agents, which can be directly attributed to the State, but it also encompasses acts by private individuals. Several scenarios can be distinguished. A first scenario is when private individuals act as de facto organs of the States. They are not officials, but they receive instructions or at least act under the effective control of state’s entities. A second scenario is when private individuals who, emboldened by hate speech or encouragement from political leaders, the media, or social media campaigns, perpetrate acts of violence or discrimination without adequate institutional response, indicating a lack of due diligence on the part of State institutions to prevent or punish such crimes. Finally, there are instances where private individuals or groups—whether acting independently, as armed groups, political organisations, de facto authorities, or criminal organisations—engage in conduct that may amount to an organisational policy, a term employed in the Rome Statute, to which I will return.
Examining the phenomenon of criminalisation of homosexuality in this broad sense, it remains challenging to obtain a comprehensive global overview. The 2023 ILGA report, « Our Identities Under Arrest » documents approximately 1,300 cases across 74 countries, 53 of which maintain explicit criminal laws against same-sex acts between adults. Other states may not formally criminalise such conduct but do so in practice, in a broader sense of the term. Notably, the report highlights the significant underreporting of incidents, including arrests and prosecutions—a phenomenon common to other types of human rights violations—suggesting that reported cases represent only the « tip of the iceberg ».
The ICC-OP Policy Paper on the Crime of Gender Persecution offers a framework for analysing when gender persecution might constitute a crime against humanity, identifying contexts such as Afghanistan, Colombia, the so-called Daesh group in Iraq, Libya, Myanmar, Nigeria, Syria, and Yemen, where such policies may be implemented by states or by organisations, including political groups.
There remains relatively little strategic litigation in this area, though there are exceptions. A few years ago, for example, Maître Deshoulières submitted a communication to the International Criminal Court concerning Chechnya, invoking the crime of genocide. Various cases have also been brought before the European Court of Human Rights, other regional human rights courts and commissions—including the African Commission on Human and Peoples’ Rights and the Inter-American Commission on Human Rights—and certain United Nations human rights treaty bodies. Greater recourse to strategic litigation before international human rights mechanisms, such as international courts or committees, would enhance the visibility of this phenomenon and underscore the extent to which such practices violate international human rights law.
I turn now to the question of the applicability of the notion of crimes against humanity. This concept, as you know, comprises two types of elements in international criminal law. First, the contextual element defines the prerequisites for the application of the category of crimes against humanity, distinguishing it from genocide or war crimes. Second, there is a set of prohibited acts, or inhumane acts, which may qualify as crimes against humanity if the contextual elements are present.
The contextual elements are defined in the chapeau of Article 7(1) of the Rome Statute, which reflects customary international law and is thus relevant beyond the jurisdiction of the International Criminal Court, including in states that have not ratified the Statute or incorporated it into domestic law. Article 7 requires that there be an “attack”, defined in Article 7(2) as a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1, pursuant to or in furtherance of a State or organisational policy to commit such an attack. Thus, it is necessary to demonstrate the commission of a series of prohibited acts, as well as the existence of an intention—on the part of a State or organisation, including criminal organisations—to pursue a policy involving such acts. This is not always easy to establish.
Furthermore, it must be shown that the attack is directed « against a civilian population ». This can be particularly complex to prove in situations of armed conflict, where it is sometimes difficult to demonstrate that civilians are specifically targeted. The attack must also be “widespread or systematic”—two alternative criteria. “Widespread” refers to a large number of victims, while “systematic” refers to the existence of a particular pattern of conduct. Finally, it must be established that the perpetrators acted with knowledge of the attack’s nature. These contextual elements distinguish crimes against humanity from genocide and war crimes, and establish a high threshold of violence, whether in terms of the number of victims or the existence of a repeated pattern of conduct. This threshold is what differentiates crimes against humanity from other “autonomous” crimes, such as torture or enforced disappearance when these crimes are not committed in the context of a widespread or systematic attack.
In the application submitted by the Prosecutor before the ICC’s Pre-Trial Chamber II under article 58 for warrants of arrests against two leaders of the Taliban in Afghanistan (23 January 2025), there is some ambiguity regarding the precise meaning of « attack »: whether it refers to Taliban actions since the 1st of May 2003 (entry into force of the Statute for Afghanistan), or whether it concerns a more specific attack comprising multiple acts of gender-based persecution. At the next stage, the Prosecutor will need to clarify whether the aim is to demonstrate a crime against humanity based on an attack specifically targeting individuals for gender-based reasons, or whether the acts form part of a broader attack within the context of Taliban policy in Afghanistan.
In conclusion, and as the subsequent speaker will explore in greater detail, it is important to consider the category of prohibited acts under Article 7 of the Rome Statute that may serve as a basis for characterising the criminalisation of homosexuality as a crime against humanity. While several of the listed crimes may be committed against individuals on the basis of their sexual orientation, gender identity or expression, or sexual characteristics, only the crime of persecution could make that specific element of discriminatory intent (dolus specialis) apparent. However, the grounds of discrimination in the definition of persecution under article 7, paragraph 1-h have been purposely restrictively drafted. “Gender” as a ground of discrimination is defined in paragraph 3 which states: “For the purpose of this Statute, it is understood that the term ‘gender’ refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term ‘gender’ does not indicate any meaning different from the above.” And paragraph 1-h indicates clearly that if other grounds not enumerated might be considered, they should be “universally recognized as impermissible under international law”. This refers to an ongoing controversy, especially at the UN Human Rights Council, where a group of States – mainly from the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) the African Group vehemently oppose the inclusion of sexual orientation and gender identity among the “universally recognized” grounds as impermissible under international law.
The ICC’s Office of the Prosecutor has clearly made a choice to resist that interpretation. In its Policy on the crime of gender persecution of December 2022, the Office supports the view that “gender-based crimes target groups such as women, men, children and LGBTQI+ persons, on the basis of gender”. Such a view was implemented in the Prosecution’s application under article 58 for a warrant of arrest against two leaders of the Taliban (23 January 2025, § 88): “Alongside its persecution of girls and women, the Taliban persecuted those who were otherwise perceived not to conform with their ideological expectations of gender identity or expression, such as members of the LGBTIQ+ community.”
But the next question then is: what will be the position of the judges when they will decide on the application?
It would be very hard to predict, if one is to take into consideration the Al Hassan judgement (26 June 2024) where the accused was acquitted of the charges of gender-based sexual violence and forced marriage because two of the three judges composing the chamber denied them, but for completely different reasons. While they did not agree on the substance, the result of their votes was to drop the charges…
Thank you for your attention.
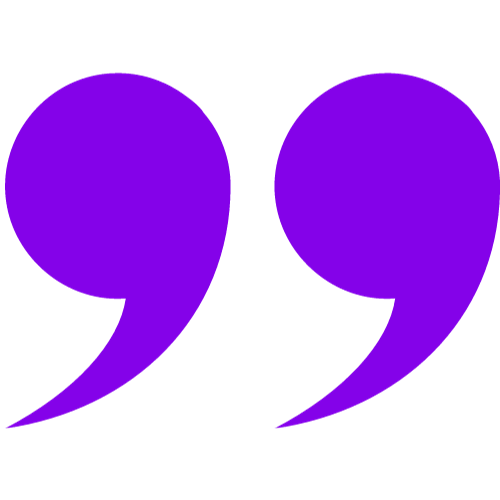

Français
Sur quels fondements les agents de l’État peuvent-ils être poursuivis ?
On m’a demandé de traiter la question de la criminalisation de l’homosexualité dans le cadre des crimes contre l’humanité. Avant de commencer, je voudrais faire écho aux déclarations faites à l’ouverture de la conférence par l’ambassadeur Berton et la présidente d’Amnesty International. Nous faisons actuellement face à une période particulièrement difficile, marquée par la montée des mouvements anti-droits. Cependant, je suis d’accord pour dire que ce n’est pas le moment de reculer dans la défense des droits humains ; c’est au contraire le moment de renouveler nos efforts et de renforcer notre unité. Toutes celles et ceux qui s’engagent pour les droits fondamentaux et pour des sociétés inclusives doivent agir collectivement pour contrer ces mouvements anti-droits et réaffirmer les valeurs d’universalité et de droits humains, qui constituent les piliers fondateurs de l’ordre international établi après-guerre. La construction de la paix et de l’égalité dépend de cet engagement collectif.
En ce qui concerne ma présentation, je souhaite clarifier ma façon d’aborder le concept de criminalisation de l’homosexualité. Je propose de comprendre ces deux termes – « criminalisation » et « homosexualité » – dans un sens large et contextuel, éclairé par les réalités de la sexualité, des identités sexuelles et des caractéristiques sexuelles. La terminologie varie selon les contextes ; certains parlent simplement « d’homosexuels », tandis que d’autres préfèrent LGBT, LGBTQI ou LGBTQI+, ce dernier terme étant plus inclusif. Ce qui unit toutes les personnes concernées, c’est l’expérience d’une criminalisation discriminatoire fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ou encore les caractéristiques sexuelles.
Ce point a été souligné dans les rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, qui affirment : « à la racine des actes de violence et de discrimination examinés se trouve l’intention de punir sur la base d’idées préconçues de ce que devraient être l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime, selon une compréhension binaire de ce qui constitue un homme et une femme, ou le masculin et le féminin, ou encore sur la base de stéréotypes de genre liés à la sexualité. »
Dans le cadre de cette conférence, le terme « homosexualité » doit donc être compris comme englobant toutes les personnes ciblées en vertu de ces conceptions préconçues du genre et, par conséquent, soumises à la criminalisation.
Il est également important d’adopter une compréhension large de la criminalisation elle-même. À un premier niveau, la criminalisation renvoie aux dispositions législatives et réglementaires qui explicitement ou implicitement criminalisent l’homosexualité ou d’autres identités ou expressions de genre non conformes. Ces lois, par leur simple existence, ont un effet dissuasif et constituent une discrimination en violation des instruments internationaux relatifs aux droits humains.
Cependant, le terme se réfère aussi souvent à l’application de ces lois et aux mesures qui en découlent – telles que la détention arbitraire, l’emprisonnement ou, dans certaines juridictions, la peine de mort – qui aggravent encore les préjudices. Il existe des situations où ces lois ne sont pas systématiquement appliquées, mais où leur présence permet ou justifie des pratiques discriminatoires. L’Ouganda en est un exemple frappant : même si la loi interdisant l’homosexualité et prévoyant la peine de mort n’est pas toujours appliquée, son existence favorise la discrimination et façonne les attitudes sociétales.
Au-delà de la loi, ou même en l’absence d’une base légale claire, il peut y avoir une criminalisation de facto des comportements homosexuels, ou l’utilisation d’autres dispositions légales pour cibler des individus pour des raisons qui, en réalité, sont liées à leur orientation sexuelle ou identité de genre.
Il est donc essentiel d’aborder la notion de criminalisation dans un sens large. La criminalisation ne concerne pas uniquement les actes perpétrés par des agents de l’État, directement attribuables à celui-ci, mais elle englobe également les actes commis par des individus privés.
Plusieurs scénarios peuvent être distingués. Un premier scénario est celui où des individus privés agissent comme des organes de facto de l’État. Ils ne sont pas des fonctionnaires, mais reçoivent des instructions ou agissent au moins sous le contrôle effectif d’entités étatiques.
Un deuxième scénario est celui où des individus privés, encouragés par des discours de haine ou des incitations de la part de dirigeants politiques, des médias ou des campagnes sur les réseaux sociaux, commettent des actes de violence ou de discrimination sans réponse institutionnelle adéquate, ce qui indique un manque de diligence de la part des institutions étatiques pour prévenir ou sanctionner ces crimes.
Enfin, il existe des cas où des individus ou des groupes privés – qu’ils agissent de manière indépendante, comme groupes armés, organisations politiques, autorités de facto ou organisations criminelles – adoptent des comportements pouvant constituer une politique organisationnelle, un terme employé dans le Statut de Rome, sur lequel je reviendrai.
Examiner le phénomène de la criminalisation de l’homosexualité dans ce sens large reste difficile pour obtenir un aperçu global complet. Le rapport de l’ILGA de 2023, « Our Identities Under Arrest », documente environ 1 300 cas dans 74 pays, dont 53 maintiennent des lois qui criminalisent explicitement les relations sexuelles entre adultes de même sexe. D’autres États peuvent ne pas criminaliser formellement ces comportements, mais le font en pratique, au sens large du terme.
Le rapport souligne notamment la forte sous-déclaration des incidents, y compris des arrestations et poursuites – un phénomène commun à d’autres types de violations des droits humains – ce qui suggère que les cas signalés ne représentent que « la partie émergée de l’iceberg ».
La note de politique du Bureau du Procureur de la CPI sur le crime de persécution fondée sur le genre fournit un cadre d’analyse permettant de déterminer quand la persécution fondée sur le genre peut constituer un crime contre l’humanité, en identifiant des contextes tels que l’Afghanistan, la Colombie, le groupe dit Daesh en Irak, la Libye, le Myanmar, le Nigéria, la Syrie et le Yémen, où de telles politiques peuvent être mises en œuvre par des États ou par des organisations, y compris des groupes politiques.
Il existe encore relativement peu de contentieux stratégique dans ce domaine, bien qu’il y ait des exceptions. Il y a quelques années, par exemple, Maître Deshoulières a soumis une communication à la Cour pénale internationale concernant la Tchétchénie, en invoquant le crime de génocide. Diverses affaires ont également été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, d’autres cours et commissions régionales des droits de l’homme – y compris la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Commission interaméricaine des droits de l’homme – ainsi que devant certains organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits humains.
Un recours accru au contentieux stratégique devant les mécanismes internationaux de protection des droits humains, tels que les cours ou comités internationaux, permettrait de mieux faire connaître ce phénomène et de souligner dans quelle mesure ces pratiques violent le droit international des droits humains.
Je me tourne maintenant vers la question de l’applicabilité de la notion de crimes contre l’humanité. Ce concept, comme vous le savez, comprend deux types d’éléments en droit pénal international. Premièrement, l’élément contextuel définit les conditions préalables à l’application de la catégorie des crimes contre l’humanité, la distinguant du génocide ou des crimes de guerre. Deuxièmement, il existe un ensemble d’actes prohibés, ou actes inhumains, qui peuvent constituer des crimes contre l’humanité si les éléments contextuels sont présents.
Les éléments contextuels sont définis dans le chapeau de l’article 7(1) du Statut de Rome, qui reflète le droit international coutumier et est donc pertinent au-delà de la compétence de la Cour pénale internationale, y compris dans les États qui n’ont pas ratifié le Statut ou qui ne l’ont pas intégré dans leur droit interne.
L’article 7 exige qu’il y ait une « attaque », définie à l’article 7(2) comme une ligne de conduite impliquant la commission multiple des actes visés au paragraphe 1, conformément à une politique d’État ou d’organisation visant à mener une telle attaque.
Il est donc nécessaire de démontrer la commission d’une série d’actes prohibés, ainsi que l’existence d’une intention – de la part d’un État ou d’une organisation, y compris des organisations criminelles – de mettre en œuvre une politique impliquant de tels actes. Ce n’est pas toujours facile à établir.
En outre, il faut démontrer que l’attaque est dirigée « contre une population civile ». Cela peut être particulièrement complexe à prouver dans des situations de conflit armé, où il est parfois difficile de démontrer que les civils sont spécifiquement visés.
L’attaque doit également être « généralisée ou systématique » – deux critères alternatifs. « Généralisée » renvoie à un grand nombre de victimes, tandis que « systématique » renvoie à l’existence d’un schéma particulier de comportement. Enfin, il faut établir que les auteurs ont agi en connaissance de la nature de l’attaque.
Ces éléments contextuels distinguent les crimes contre l’humanité du génocide et des crimes de guerre, et établissent un seuil élevé de violence, que ce soit en termes de nombre de victimes ou de l’existence d’un schéma répété de comportement. Ce seuil est ce qui différencie les crimes contre l’humanité d’autres crimes « autonomes », tels que la torture ou la disparition forcée, lorsque ces crimes ne sont pas commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique.
Dans la demande soumise par le Procureur devant la Chambre préliminaire II de la CPI au titre de l’article 58 pour des mandats d’arrêt contre deux dirigeants talibans en Afghanistan (23 janvier 2025), il existe une certaine ambiguïté quant à la signification précise du terme « attaque » : s’agit-il des actions des talibans depuis le 1er mai 2003 (date d’entrée en vigueur du Statut pour l’Afghanistan), ou d’une attaque plus spécifique comprenant de multiples actes de persécution fondée sur le genre ?
À l’étape suivante, le Procureur devra clarifier s’il s’agit de démontrer un crime contre l’humanité basé sur une attaque ciblant spécifiquement des individus pour des raisons liées au genre, ou si les actes font partie d’une attaque plus large dans le cadre de la politique des talibans en Afghanistan.
En conclusion, et comme l’orateur suivant le développera plus en détail, il est important de considérer la catégorie des actes prohibés énumérés à l’article 7 du Statut de Rome qui peuvent servir de base pour qualifier la criminalisation de l’homosexualité de crime contre l’humanité.
Bien que plusieurs des crimes listés puissent être commis contre des individus en raison de leur orientation sexuelle, identité ou expression de genre, ou de leurs caractéristiques sexuelles, seul le crime de persécution peut mettre en évidence cet élément spécifique d’intention discriminatoire (dolus specialis).
Toutefois, les motifs de discrimination dans la définition de la persécution à l’article 7, paragraphe 1-h ont été rédigés volontairement de manière restrictive. Le « genre » comme motif de discrimination est défini au paragraphe 3 qui stipule : « Aux fins du présent Statut, il est entendu que le terme “genre” désigne les deux sexes, masculin et féminin, dans le contexte de la société. Le terme “genre” n’a pas de signification différente de celle qui précède. »
Et le paragraphe 1-h indique clairement que si d’autres motifs non énumérés peuvent être pris en compte, ils doivent être « universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ».
Cela renvoie à une controverse en cours, notamment au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, où un groupe d’États – principalement de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et du Groupe africain – s’oppose vigoureusement à l’inclusion de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre parmi les motifs « universellement reconnus » comme inadmissibles en droit international.
Le Bureau du Procureur de la CPI a clairement fait le choix de résister à cette interprétation. Dans sa politique sur le crime de persécution fondée sur le genre de décembre 2022, le Bureau soutient l’idée que « les crimes fondés sur le genre ciblent des groupes tels que les femmes, les hommes, les enfants et les personnes LGBTQI+, sur la base du genre ».
Cette approche a été appliquée dans la demande du Procureur au titre de l’article 58 pour un mandat d’arrêt contre deux dirigeants talibans (23 janvier 2025, § 88) : « Parallèlement à sa persécution des filles et des femmes, les talibans ont persécuté celles et ceux qui étaient perçus comme ne se conformant pas à leurs attentes idéologiques en matière d’identité ou d’expression de genre, comme les membres de la communauté LGBTIQ+. »
La question suivante est donc : quelle sera la position des juges lorsqu’ils se prononceront sur cette demande ?
Il serait très difficile de prévoir leur décision, surtout si l’on tient compte de l’affaire Al Hassan (26 juin 2024) où l’accusé a été acquitté des charges de violence sexuelle fondée sur le genre et de mariage forcé parce que deux des trois juges composant la chambre les ont rejetées, mais pour des raisons complètement différentes. Bien qu’ils ne soient pas d’accord sur le fond, le résultat de leurs votes a été l’abandon de ces charges…
Merci de votre attention.