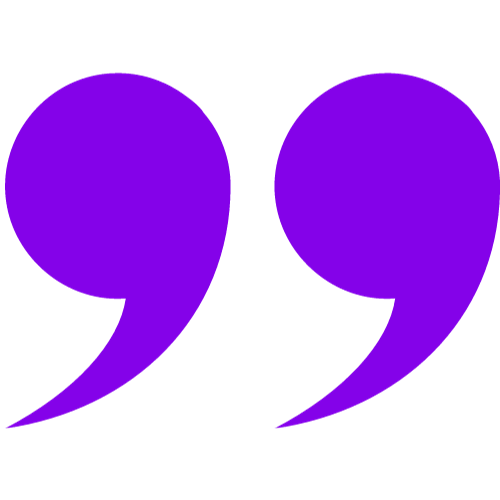Prf. Benjamin Moron Puech
Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Lyon 2Accueil »
Benjamin Moron-Puech est professeur agrégé de droit privé et de sciences criminelles à l’université Lumière Lyon 2 (CERCRID et Transversales) et chercheur associé au Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Paris-Panthéon-Assas.
Benjamin Moron-Puech a mené sa présentation sur la responsabilité de l’Etat français vis-à-vis de la criminalisation de l’homosexualité de 1942 à 1982.

English
The liability of the French State for the criminalization of homosexuality from 1942 to 1982.
Good evening everyone. I am very happy to be here. I would like to thank the organizing NGO for the invitation and Étienne Deshoulières. I would also like to warmly thank Ioannis Sokolakis, who helped me prepare this presentation, and my friend Régis Schlagdenhauffen, who supported me with the social data.
I am speaking as a scholar who has been working for several years on reparations for certain mass crimes, particularly those committed in France in the past against intersex people. Until now, we have mostly talked about reparations for current crimes. Reparations for past mass crimes raise a number of additional difficulties. So, my topic, as Étienne mentioned, is to see whether there might be a legal way to hold the French authorities accountable for the criminalization of homosexuality.
As for the timeframe, I focused on what Antoine Idier earlier called the “homophobic framing,” meaning the period from 1942 to 1982. During this period, we at least have a clear legal text to discuss, which makes it a bit easier to target the responsibility of the State. Of course, I understand that the criminalization went through many other frameworks, as both Antoine Idier and, before him, Régis Schlagdenhauffen reminded us.
This responsibility of the State, in legal terms, as you know, can be either criminal or civil. The criminal liability of a legal entity was not possible before 1994 with the new penal code, and even since 1994, the State itself cannot be prosecuted.
We might consider prosecuting individuals, people working for the State. The problem is that the 1942 law partially criminalizing homosexuality was not annulled at the time. Therefore, individuals acted under the authority of this law and can claim the legal justification of “authorization by law” to avoid responsibility. So, in my view, the path of criminal liability cannot be pursued.
This brings us to civil liability, which can be brought before a civil judge, an administrative judge, or an international judge.
The civil judge is only competent in very limited cases known as voie de fait. Ioannis Sokolakis explored this possibility before this presentation, but it is not realistically feasible. So, under domestic law, we are left with administrative liability and, secondarily, international liability.
For the administrative judge, there are several types of liability: fault-based liability, strict liability, and a special liability for laws that conflict with international treaties or the Constitution. It is this last option that I will explore in my presentation.
Let us start by examining whether there is a chance that this action could succeed on its merits (I). Then we will look at admissibility issues, particularly the problem of the statute of limitations, which is crucial when dealing with events that occurred decades ago (II). Finally, given the risk that the action might be dismissed despite its merits, we will consider civil liability before an international judge (III).
On the merits of the action, starting with liability for laws contrary to the Constitution – and then we will look at liability for laws contrary to international treaties. The first idea one might have is to ask: “Could this 1942 law be unconstitutional?” To answer this, we need to distinguish between three periods, as the constitutional regime changes: 1958 to 1982 (Fifth Republic), 1946 to 1958 (Fourth Republic), and 1942 to 1946 (French State / Third Republic).
For the first period, one could say: “But no, this is a law prior to 1958, how could it be unconstitutional?” This overlooks the fact that the Constitutional Council has already ruled on texts predating 1958 and has held that as long as the effects occurred after 1958, it is possible to challenge them. So, for all the people who were prosecuted between 1958 and 1982, during the Fifth Republic, it would be possible to raise a Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to have the law annulled and to establish that it engaged the State’s liability because it was unconstitutional.
Another potential problem is whether one can raise a QPC against a law that has already been repealed, since the 1942 law was repealed in 1982. The Constitutional Council has confirmed that it is indeed possible to challenge repealed laws.
However, the question remains whether it is necessary to go through the Constitutional Council to establish the State’s liability for an unconstitutional law. Couldn’t one directly go before an administrative judge? The answer is no. When, in 2019, the Conseil d’État first recognized the State’s liability for unconstitutional laws, it clearly stated that the case must first go through the Constitutional Council. This is a way of locking the process, and they added another lock by requiring that the action must not be time-barred. We will address the issue of the statute of limitations later.
So, for events occurring after 1958, there is a path to have the 1942 law declared unconstitutional and to establish the State’s liability. But what about before 1958, when the law was already producing effects?
For the second period, 1946 to 1958, Ioannis Sokolakis pointed out in his preparatory work that there is a constitutional principle of human dignity that could be invoked to argue that the law was unconstitutional. This principle of dignity was identified by the Constitutional Council in 1994, based on the preamble to the 1946 Constitution. Because this interpretation is retroactive, it could apply to convictions of homosexual persons during that period.
Finally, for the period prior to 1946, things are more complicated. In its 2009 Hoffman-Glemane decision, which considered the State’s liability for the deportation of Jews during World War II, the Conseil d’État relied on a principle of dignity derived from the Declaration of the Rights of Man and major laws of the Third Republic. The issue here is that under the Third Republic, there was no hierarchy of norms. In other words, a law could contradict a principle, but there was no clear rule stating that the principle was superior to the law. This makes it difficult to establish State liability for an unconstitutional law when the very concept of a superior constitution was shaky at the time.
Thus, in my view, if one wants to have a relatively solid case, it would be safer to focus on the period between 1946 and 1982. That covers liability for unconstitutional laws before an administrative judge. Now let’s turn to liability for laws contrary to international treaties.
For this type of liability, two main frameworks come to mind: the notion of crimes against humanity and the European Convention on Human Rights. Regarding crimes against humanity, I believe this is a false lead. The Rome Statute, which my colleagues have discussed extensively, only came into force in 2002, and Article 28 clearly states that it is not retroactive. Therefore, acts committed before 2002 cannot be considered under this statute.
You might argue that the concept of crimes against humanity existed before 2002, notably in the agreements establishing the Nuremberg Tribunal, or perhaps as a customary international norm. While the Nuremberg agreements did define crimes against humanity, they focused specifically on acts committed during World War II. The 1942 law on homosexuality does not directly relate to such wartime acts, so this treaty cannot be relied upon.
As for customary international law, even if there is a general customary rule prohibiting crimes against humanity, custom ranks below statute in the hierarchy of norms. This means the legislature cannot be held liable for failing to respect a rule that is legally inferior to a statute. The second avenue is the European Convention on Human Rights, which France only ratified in 1974. This delay was partly due to issues like torture during the Algerian war and the decision to wait until decolonization was complete before ratifying.
For events occurring after 1974, it becomes possible to consider State liability for violating the Convention. Which violations could be invoked? Étienne and I discussed beforehand the possibility of relying on Article 5, which prohibits arbitrary detention.
The difficulty is that the detentions of homosexual individuals were based on court decisions applying the law, and the Convention states that detentions must be “lawful.” If the law itself was valid at the time, this complicates the argument. However, if the 1942 law were annulled, these convictions might lose their legal basis, potentially opening the door to a claim under Article 5, though the path is indirect and complex.
A more straightforward approach would be to rely on Article 8, which protects the right to privacy, Article 3 on inhuman or degrading treatment, and Article 14 on discrimination. The landmark case here is Dudgeon v. United Kingdom, where the Court first held that criminalizing homosexuality violated Articles 8 and 14.
The timing is important. The Court often assesses State conduct based on the norms in force at the time of the acts. In Dudgeon, the events dated to 1976, which is very close to 1974, the year the Convention took effect in France. Therefore, it seems reasonable to apply Dudgeon from 1974 onward.
This means that maintaining a law criminalizing homosexuality between 1974 and 1982 in France could be considered a violation of the Convention.
Unlike for constitutional violations, the Conseil d’État does not require a prior ruling from the European Court of Human Rights. It can itself determine that a law violates the Convention and hold the State liable directly.
Thus, there appear to be solid grounds for action, either based on unconstitutionality or on a violation of the Convention.
However, a major problem remains: the statute of limitations. This brings us to the question of admissibility.
Regarding the statute of limitations, there are two possible approaches to try to overcome this obstacle. The first would be to consider the principle of non-prescription for crimes against humanity, and if that does not work, to turn to the general rule of French public law known as the four-year limitation period.
The non-prescription for crimes against humanity was established in France by a 1964 law. However, this applies to criminal actions, not civil actions. Several lower courts have confirmed this, as Nicolas Chifflot recently reminded us in his article in the book Réparer les crimes du passé, published by Dalloz and directed by Delphine Porcheron, among others. As recently as last February in Nice, a case concerning someone who had been sentenced to forced labor during the war was rejected on these grounds. In general, administrative judges hold that non-prescription applies only to criminal matters, not civil. The Conseil d’État has not ruled yet, but since it tends to protect the State’s finances, it is very unlikely it would adopt a different position. This makes it improbable that the non-prescription of crimes against humanity could apply to civil liability.
The second option is the four-year limitation period. This rule gives you four years to act, starting from the day you became aware of all the elements of your harm and were able to attribute it to a specific authority. In this case, it seems clear that once someone was convicted and served their sentence, they knew who had condemned them. Therefore, this avenue appears very difficult.
One could then ask whether French rules on prescription conflict with international law. This would bring us back to the question of holding the French State civilly liable before an international court.
Here we return to the European Convention on Human Rights, which allows for State liability when a member State violates the Convention. Such liability could be invoked primarily on the basis of Article 3, which prohibits torture and inhuman or degrading treatment. Importantly, Article 3 has a procedural component that obliges States to respond to such acts, including through criminal proceedings.
It would be necessary to distinguish between the type of claim brought before the administrative courts. If the initial claim was for financial compensation, the obstacle would again be the four-year limitation rule. This rule has been challenged twice before the European Court of Human Rights.
The first time was in the case of the children displaced from overseas territories to Creuse. These individuals were moved, often without full parental consent, to repopulate the region. When they became adults and learned the truth, they took legal action against the French State. Most of these actions failed. They then brought the matter to the European Court of Human Rights, which declared the case inadmissible in a decision dated December 15, 2011, that was never made public.
Eleven years later, in another case involving sexual violence (Loste v. France), the Court condemned France for refusing to accept an action against the State that had been rejected by domestic courts because of the four-year limitation period. However, the Court justified its decision by referring to very specific circumstances, suggesting that in other, less exceptional cases, it might rule differently.
In that case, the victim had made multiple attempts to access their file and understand what had happened, as there were gaps in their personal history. This is not the same situation for individuals convicted of homosexuality, who had clear decisions issued against them and knew which authorities were responsible. For this reason, challenging the four-year limitation period when seeking monetary compensation seems extremely difficult.
On the other hand, if the claim is not about money but about other forms of reparation—such as apologies, symbolic recognition, or the creation of memorial sites—the four-year limitation may not apply. The issue of timing is then less clear. If the Conseil d’État were to declare even this type of claim time-barred, there might still be grounds to appeal to the European Court of Human Rights.
It is worth recalling that in the Hoffman-Glemane case, the Conseil d’État stated that financial measures alone were not sufficient to address crimes against humanity and that other forms of reparation were necessary, including symbolic recognition. A legal action could, for example, aim to have the 1942 law annulled as part of proceedings to erase criminal records, or to compel the State to issue a formal apology.
Such a case could potentially achieve both recognition and the annulment of this shameful 1942 law. This is especially relevant in light of the upcoming debates on May 5 in Parliament. The question of reparations is not only political. As I have tried to show here today, it is also a legal matter that must be addressed through the courts as well as through public policy.
Thank you.
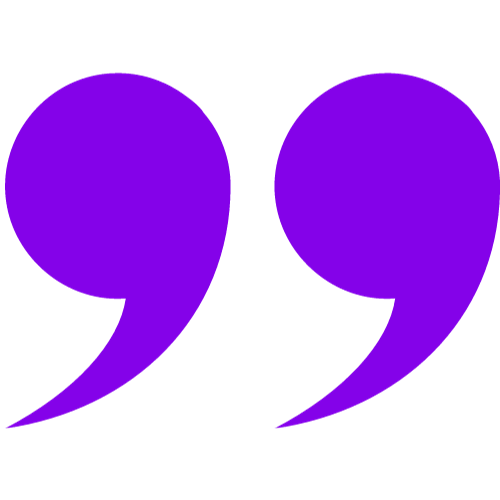

Français
Quelle responsabilité pour l’Etat français, en raison de la criminalisation de l’homosexualité de 1942 à 1982 ?
Bonsoir à tous. Je suis très heureux d’être là. Je tiens à remercier l’ONG organisatrice pour l’invitation et Étienne Deshoulières. Je tiens également à remercier chaleureusement Ioannis Sokolakis, qui m’a aidé à préparer cette intervention et mon ami Régis Schlagdenhauffen, qui m’a soutenu pour les données sociales.
Je parle en tant qu’universitaire qui travaille depuis plusieurs années sur la réparation de certains crimes de masse, en particulier de ceux commis en France, dans le passé, sur les personnes intersexes. Jusqu’à présent, on a plutôt parlé de la réparation des crimes actuels. La réparation des crimes de masse dans le passé pose un certain nombre de difficultés supplémentaires. Donc, mon sujet, comme l’a dit Étienne, c’est d’essayer de trouver s’il existerait une voie juridique pour engager la responsabilité des autorités françaises pour la pénalisation de l’homosexualité. Concernant la délimitation temporelle, je m’en suis tenu au « cadrage homophobe », pour reprendre les mots d’Antoine Idier de tout à l’heure, soit la période 1942-1982. Parce que là, au moins, nous avons un texte clair à discuter et donc c’est un peu plus facile pour cibler la responsabilité de l’État. Mais j’entends bien sûr que la pénalisation est passée par bien d’autres cadres, comme l’a rappelé Antoine Idier et avant lui Régis Schlagdenhauffen. Alors, cette responsabilité de l’État en droit, vous le savez, elle peut être de nature pénale ou civile. La responsabilité pénale d’une personne morale, ça n’est pas possible avant 1994, le nouveau code pénal. Et même depuis 1994, l’État ne peut pas être touché.
On pourrait envisager d’attaquer des individus en particulier. On pourrait envisager d’attaquer des personnes physiques travaillant pour l’État. Le problème, c’est que la loi de 1942 criminalisation en partie l’homosexualité n’a pas été annulée, de sorte que c’est une loi en application de laquelle des individus ont agi et, dès lors, ils peuvent se prévaloir du fait justificatif dit de l’« autorisation de la loi » pour être exonérés de toute responsabilité. Donc, il me semble, que la voie de la responsabilité pénale ne peut pas être retenue. Venons-en à la responsabilité civile, qui peut être engagée devant un juge civil, un juge administratif ou un juge international.
Le juge civil n’est compétent que dans un cas très limité qu’on appelle la voie de fait ; Ioannis Sokolakis a exploré cette possibilité en amont de cette communication ; elle n’est pas raisonnablement envisageable. Donc, en droit interne il ne nous reste que la responsabilité devant le juge administratif et subsidiairement devant le juge international. Alors, pour le juge administratif, il existe plusieurs types de responsabilités : la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Et une responsabilité spéciale pour les lois qui seraient contraires aux traités internationaux ou à la Constitution. Et c’est cette piste-là qu’il me semble intéressant d’explorer dans mon intervention.
Alors, commençons par regarder d’abord la question de la possibilité de cette action : est-ce qu’il y a une chance qu’elle soit bien fondée? Et puis ensuite, je regarderai les questions de recevabilité, notamment la problématique de la prescription qui est cruciale quand on parle de faits qui se sont passés il y a de cela plusieurs décennies. Enfin, compte tenu du risque que malgré son bien-fondé l’action soit jugée irrecevable, on examinera la responsabilité civile devant le juge international.
Donc, sur le bien-fondé de l’action, en commençant par la responsabilité pour des lois contraires à la Constitution – on verra ensuite celle pour des lois contraires au traité –, la première idée que l’on pourrait avoir, c’est de se dire : « Cette loi de 1942, est-ce qu’elle ne serait pas anticonstitutionnelle ? ». Pour répondre à cela il faut distinguer selon 3 périodes car le régime constitutionnel change : 1958 à 1982 (Ve République), 1946 à 1958 (IVe République) et 1942 à 1946 (État français / IIIe République).
Alors, sur la première période on pourrait me dire : « Mais non, c’est une loi qui est antérieure à 1958, comment pourrait-elle être anticonstitutionnelle ? »
C’est oublier que le Conseil constitutionnel a été saisi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur des textes antérieurs à 1958 et qu’il a pu dire « non, non, c’est possible : tant que les effets se sont produits après 58, c’est bon ». Donc on pourrait dire que pour toutes les personnes qui ont été poursuivies entre 1958 et 1982, on est bien sous la 5e République, donc il serait possible à ce titre-là d’agir par une question prioritaire de constitutionnalité pour obtenir l’annulation de cette loi, et de faire reconnaître que cette loi engage la responsabilité de l’État en raison de son inconstitutionnalité.
L’autre difficulté qui peut se poser serait : est-ce que on peut faire des QPC contre des lois qui ont été abrogées ? Puisqu’en effet, cette loi de 1942 a été abrogée en 1982. Là encore, le Conseil a dit : « pas de problème, on peut faire des QPC contre des lois abrogées ».
Alors, la question qu’on pourrait maintenant se poser, c’est : est-ce qu’il est vraiment nécessaire de faire toute cette démarche devant le Conseil constitutionnel pour obtenir la responsabilité de l’État pour avoir voté une loi anticonstitutionnelle ? Est-ce qu’on ne pourrait pas directement aller devant un juge administratif ? La réponse est non. Parce que le Conseil d’État, lorsque pour la première fois, en 2019, il a reconnu la responsabilité de l’État pour des lois contraires à la Constitution, a bien dit : « Attention, il faut que ça passe par le Conseil constitutionnel. » Une manière pour lui de verrouiller, et il a verrouillé d’une 2ᵉ manière en disant qu’il ne fallait pas que ça soit prescrit. Nous verrons la question de la prescription un peu plus loin.
Donc, vous le voyez, du côté de ce qui s’est passé après 1958, il y a une possibilité d’agir pour faire déclarer cette loi anticonstitutionnelle et donc caractériser une faute de l’État français, une responsabilité en raison d’une loi anticonstitutionnelle. Mais avant 1958 – puisque la loi a aussi bien sûr produit des effets avant 58 – qu’est-ce qu’on peut faire ?
Alors, avant 1958, sur la deuxième période allant de 1946 à 1958, comme Ioannis Sokolakis l’a relevé dans son travail préparatoire, il y a le principe de dignité qui est un principe constitutionnel sur lequel on pourrait s’appuyer pour argumenter de l’inconstitutionnalité. Ce principe de dignité, il a été dégagé en 1994 par le Conseil constitutionnel sur le fondement d’un texte de 1946 : le préambule de la Constitution de 1946. Comme cette interprétation est rétroactive, on peut dire que pour toutes les condamnations de personnes homosexuelles sur la période de 1946 à 1958 on devrait pouvoir faire quelque chose.
Qu’en est-il enfin pour la dernière période, celle antérieure à 1946 ? Là, c’est un peu plus compliqué, mais le Conseil d’État, dans l’arrêt Hoffman-Glemane de 2009 – un arrêt très important qui envisage la possibilité d’une responsabilité de l’État pour la déportation des Juifs pendant la 2ᵉ Guerre mondiale – va s’appuyer sur un principe de dignité qui découlerait de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que des lois importantes de la 3ᵉ République. Le problème, c’est que, dans la 3ᵉ République – puisqu’entre 42 et 46 on est fictivement dans la 3ᵉ République – il n’y a pas de hiérarchie des normes. Donc, il y a une loi de 42 qui est contraire à un principe, mais on ne sait pas si vraiment ce principe, il est contraire à la loi de 42, s’il est au-dessus de la loi de 42. Donc ça me paraît compliqué d’engager la responsabilité de l’État pour une loi anticonstitutionnelle, alors que sous la 3ᵉ République la notion de Constitution qui serait supérieure à une loi est un peu bancale. Donc, à mon avis, si on veut faire quelque chose d’à peu près sûr, il faut aller entre 46 et 82. Voilà pour la responsabilité de l’État qui pourrait être engagée pour des lois contraires à la Constitution devant le juge administratif. Qu’en est-il pour la responsabilité pour des lois contraires à des traités internationaux.
Pour cette responsabilité, on pense naturellement d’abord à la notion de crimes contre l’humanité, présente dans différents supports normatifs ; mais il y a aussi la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Alors, pour les crimes contre l’humanité, à mon avis, c’est une fausse piste, parce que le statut de Rome, qui a été longuement évoqué par mes collègues, n’entre en vigueur qu’en 2002, et il est bien dit dans l’article 28 du statut de Rome que ça n’est pas rétroactif. Donc tous les faits antérieurs à 2002 ne peuvent pas être concernés par la qualification de crime contre l’humanité. Alors, vous pourriez toutefois me dire : « mais cette notion de crime contre l’humanité, elle est bien plus ancienne ! N’était-elle pas présente dans le texte qui a créé le tribunal de Nuremberg ou à tout le moins n’est-ce pas une sorte de coutume internationale ? ». Certes, la notion de crime contre l’humanité est bien présente et définie dans l’accord qui a permis de créer le tribunal de Nuremberg et de juger les criminels nazis. Sauf que, dans ces accords de Nuremberg, qu’est-ce qui est ciblé ? Ce sont les violations pendant la 2ᵉ Guerre mondiale. Or là, avec la loi de 1942 on n’est pas tellement sur des faits liés à la 2ᵉ Guerre mondiale, donc on ne peut guère s’appuyer sur ce traité-là.
Ensuite, quant à la coutume internationale, on pourrait certes considérer qu’il y a une coutume qui interdit les crimes contre l’humanité. Le problème, c’est que la coutume, dans la hiérarchie des normes, elle est en dessous de la loi. Donc on ne peut pas engager la responsabilité du législateur pour ne pas avoir respecté une norme qui est inférieure à la loi, donc ça ne marcherait pas.
Ne désespérons pas, il nous reste la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, celle-ci n’est entrée en vigueur qu’en 1974, notamment parce qu’il y avait un certain nombre d’actes de torture en Algérie et on voulait attendre d’avoir fini la décolonisation pour ratifier cette convention. Donc, pour tout ce qui est postérieur à 1974, là, on pourrait envisager d’engager la responsabilité de l’État français pour une violation de la convention. Alors, quelle violation de la convention pourrait-on envisager ? Avec Étienne, on a discuté en amont de cette conférence de la possibilité de mobiliser l’article 5 de la convention, qui est l’article qui interdit les détentions arbitraires. Le seul problème, c’est que ce sont des détentions qui ont été prononcées sur la base de décisions de justice pour, éventuellement, les personnes homosexuelles qui auraient été emprisonnées. Or, la Convention dit que les détentions doivent avoir été ordonnées selon la voie légale, ce qui semble être le cas. Alors, peut-être que si on obtenait l’annulation de la loi de 1942, il n’y aurait plus de bases légales pour ces condamnations et donc on pourrait dire qu’il n’y a plus de voie légale, mais ce n’est pas extrêmement simple et pas très direct comme cheminement.
Il y a, à mon avis, un moyen plus sûr et plus simple que l’article 5, c’est de partir sur la violation du droit au respect de la vie privée, l’article 8, éventuellement les traitements inhumains et dégradants, l’article 3, et la discrimination, l’article 14. On pourrait ainsi s’appuyer sur l’arrêt Dudgeon contre le Royaume-Uni, le premier arrêt à avoir considéré que la pénalisation de l’homosexualité était une violation de l’article 8 et de l’article 14. Il faut néanmoins prêter attention à la date des faits, car la Cour précise souvent qu’il faut juger les comportements des États par rapport aux normes pplicables au jour où ces comportements se sont produits. Alors, dans Dudgeon, de quand datent les faits ? Ils datent de 76. Or, 1976, c’est presque 1974, date d’entrée en vigueur de la Convention. Donc je pense qu’on peut considérer que la décision Dudgeon peut s’appliquer dès 1974 en France. Donc, sur le fondement de Dudgeon, on pourrait considérer que maintenir une loi pénalisant l’homosexualité en France entre 1974 et 1982 était une violation de la Convention.
C’est bon à savoir par rapport à ce qu’on a dit plus haut sur la responsabilité du fait de lois anticonstitutionnelles. En effet, pour la violation de la Convention, le Conseil d’État n’exige pas une déclaration préalable de la Cour européenne des droits de l’homme disant que la France a violé la convention ; il peut le faire de lui-même. De lui-même, il peut donc estimer qu’on a violé la Convention et de lui-même il peut engager la responsabilité de l’État. À partir de là, on peut se dire qu’on des pistes dont le bien-fondé paraît assez solide, soit sur le terrain d’une loi contraire à la Constitution, soit sur le terrain d’une loi contraire à la Convention.
Cependant un problème demeure, celui de la prescription. Et donc, on en arrive à la question de la recevabilité.
Alors, sur la prescription, on peut penser à 2 choses pour contourner cet obstacle : on peut penser à l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, et puis, si ça ne marche pas, on peut éventuellement penser à une grande règle du droit public qui est la prescription quadriennale.
L’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité a été affirmée en France par une loi de 1964. Le problème, c’est que l’on parle de l’imprescriptibilité pour l’action pénale, pas pour l’action civile. Il y a pas mal de juridictions du fond qui se sont prononcées en ce sens comme le rappelait encore récemment Nicolas Chifflot dans son article au sein de l’ouvrage récemment paru chez Dalloz et dirigé notamment par Delphine Porcheron : Réparer les crimes du passé. Encore en février dernier à Nice, pour quelqu’un qui avait été condamné au travail forcé obligatoire pendant la guerre cela a été refusé. Schématiquement, les juges administratifs disent : « l’imprescriptibilité ne fonctionne que pour le pénal, pas pour le civil ». Le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé là-dessus, mais on dit souvent en doctrine que le Conseil d’État s’occupe de protéger les finances publiques de l’État. Donc il me paraît très peu probable qu’il fasse ce que les juges du fond ont refusé de faire. A mon avis, sur le terrain de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, c’est mal engagé.
Reste la prescription quadriennale. Alors, la prescription quadriennale, c’est le fait que vous avez quatre ans pour agir. Quatre ans à partir de quand ? Quatre ans à partir du jour où vous avez connu tous les éléments de votre préjudice et du jour où vous êtes capable d’imputer ce préjudice à une autorité.
Il me semble qu’à partir du moment où vous avez été condamné, où vous avez purgé votre peine de prison, vous savez très bien qui vous avez condamné, donc ça semble assez mal engagé du côté de la prescription quadriennale. Alors ne pourrait-on pas dire que les règles du droit français sur la prescription quadriennale sont contraires au droit international, ce qui reviendrait à poser (enfin !) la question de la responsabilité civile de l’État français devant le juge international ?
Nous en revenons ici à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui permet d’engager la responsabilité (« civile ») des États membres en cas de violation de la convention. Cette responsabilité pourrait être engagée sur le terrain à mon avis avant tout de l’article 3 prohibant la torture et les autres traitements inhumains et dégradants, dans son volet procédural, obligeant aux États de réagir à de tels actes, y compris par la voie pénale. Il faudrait toutefois distinguer selon l’objet de la demande introduite devant les juridictions administratives et qui aurait échoué : une demande indemnitaire ou autre.
S’agissant des demandes indemnitaires, l’obstacle serait donc celui de la prescription quadriennale. Cette prescription quadriennale a été contestée à 2 reprises devant la Cour européenne des droits de l’homme.
La première fois c’était dans l’affaire des déplacés de la Creuse, ces personnes d’outre-mer qui ont été emmenées plus ou moins de force avec plus ou moins le consentement de leurs parents pour faire du repeuplement de la Creuse. Ces personnes se sont organisées, parvenues à l’âge adulte, pour connaître la réalité de leur situation. Elles ont poursuivi l’État français ; la plupart de ces actions ont échoué. Elles ont porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme et elles ont été déboutées par une décision d’irrecevabilité qui n’a jamais été rendue publique du 15 décembre 2011.
Néanmoins, 11 ans plus tard, dans une autre affaire de violences sexuelles (Loste c. France), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir refusé d’accepter une action en responsabilité contre l’État français. L’action avait au préalable échoué sur la prescription quadriennale devant le juge administratif. Si la Cour européenne a condamné la France, elle a néanmoins motivé sa décision en disant qu’il y avait des circonstances très particulières. Ce qui permet de penser que, dans d’autres circonstances qui seraient moins particulières, elles ne rendraient pas la même décision. Quand on va voir ces circonstances, on se rend compte que la personne avait fait les démarches pour essayer de connaître son dossier, d’essayer de comprendre ce qu’il s’était passé car il y avait des trous dans son histoire. Ce qui ne semble pas être le cas pour les personnes condamnées pour homosexualité qui avaient une décision claire, qu’elles pouvaient imputer à des autorités. Donc il me semble que, du côté de la prescription, c’est assez difficile, du moins si l’on cherche de l’argent car c’est à cela avant tout que la prescription quadriennale s’applique.
En revanche, si on cherche autre chose que de l’argent (telles des excuses, une reconnaissance symbolique, la création de lieux de mémoire), là, la prescription quadriennale ne paraît pas devoir s’appliquer. On est alors néanmoins dans le flou concernant le délai de prescription. Imaginons que pour une telle demande, le Conseil d’État la déclare malgré tout prescrite, alors il me semble qu’on pourrait faire quelque chose devant la Cour européenne. Rappelons en outre que, dans l’arrêt Hoffmann-Glemane que j’ai cité tout à l’heure, le Conseil d’État a dit qu’on ne pouvait pas s’en tenir à des mesures financières pour les crimes contre l’humanité et qu’il fallait d’autres types de réparations, notamment la reconnaissance symbolique. Est-ce qu’une décision devant le Conseil constitutionnel qui tendrait, par exemple, à obtenir l’annulation de cette loi dans un contentieux qui porterait sur l’effacement du casier judiciaire, ou un contentieux qui viserait à exiger de l’État français des excuses, serait suffisant ? Est-ce que, dans le cadre de ce contentieux-là, on ne pourrait pas à la fois obtenir la reconnaissance et l’annulation de cette loi honteuse de 1942 ?
C’est en tout cas une perspective qui mériterait d’être examinée, surtout dans le cadre des débats qui auront lieu le 5 mai prochain devant le Parlement. Car la question n’est pas que politique. La question des réparations, elle est aussi juridique, comme j’ai essayé de vous le montrer en cette fin de journée. Je vous remercie.