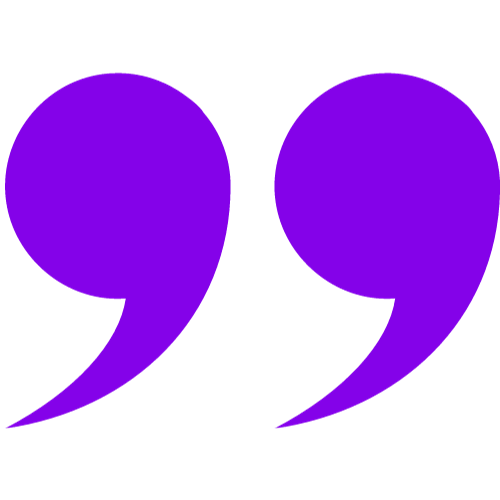Camille Schaltenbrand
Juriste en droit international à Stop HomophobieAccueil »
Camille Schaltenbrand est juriste spécialisée en droit pénal international et droits humains. Elle travaille au sein de l’association Stop Homophobie, où elle œuvre à la défense et à la représentation des minorités sexuelles et de genre victimes de discriminations et de violences. Forte d’expériences au sein d’institutions telles que la Cour pénale internationale, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Institut Ludwig Boltzmann, elle met son expertise au service de la protection et de la promotion des droits humains à l’échelle internationale.
Camille Schaltenbrand a mené une présentation sur les critères d’admissibilité et de compétence devant la Cour Pénale Internationale à partir des situations en Ouganda et en Afghanistan, où les droits des minorités sexuelles et de genre sont particulièrement menacés.

English
Can the International Criminal Court be seized in connection with the criminalisation of homosexuality?
Can the International Criminal Court be seized in connection with the criminalisation of homosexuality? Does the ICC have jurisdiction ratione personae, ratione loci and ratione temporis? How does the principle of complementarity apply to situations where LGBTQ+ people are victims of atrocious crimes?
Thank you very much for the floor, Etienne, I am pleased to open the third panel. I will not predict the future. The purpose of my presentation is to determine whether or not there is a legal avenue for the ICC to deal with situations and potential cases involving crimes against sexual and gender minorities. I will take all the conditions of jurisdiction and admissibility for crimes committed on the territories of Uganda and Afghanistan and show how they are, or not, met. It is a means of concluding the second part on the substance of the law in order to begin that part relating to the procedure.
As regards the possibility of bringing cases before the ICC in relation to crimes allegedly committed in Uganda, this seems prima facie possible under the applicable law. In particular, the ICC has already examined a situation in Uganda regarding war crimes and crimes against humanity committed in the context of a conflict between the Lord’s Resistance Army (LRA) and national authorities in Uganda since 1 July 2002. Two cases have already been heard by the Court: those of Joseph Kony and Dominic Ongwen. So there is already a ground at the ICC for Uganda to be examined for crimes against LGBT+ people.
For Afghanistan, we have a basis with the Prosecutor’s Office’s request of arrest warrants dated 23 January this year, targeting two Taliban leaders, which shows the Prosecutor’s willingness to focus on that country when it comes to crimes targeting the LGBT community. Although the Chambers have not yet confirmed the application, this document provides a good basis for examining the jurisdiction and admissibility of alleged crimes in Afghanistan. Even though the situation in Afghanistan and Uganda is politically sensitive and gender crimes are difficult to highlight in these two countries because of their contentious nature, and although we do not know what the future holds, the mere referral of these issues and offences by the ICC’s Prosecutor remains a symbolic gesture in favour of universal rights and the protection of minorities.
Concerning the jurisdiction ratione temporis (article 11 of the Rome Statute), Uganda ratified the Rome Statute on 14 June 2002. Afghanistan ratified the Rome Statute on 10 February 2003. To date, both are still Member States of the Court, so the time requirement is met. On the jurisdiction ratione materiae (article 5) as discussed before, the crimes under the jurisdiction of the ICC include crimes against humanity of persecution. On the jurisdiction ratione loci/personae (article 12), the crimes were allegedly committed on the territory of Uganda and by nationals of the Ugandan state. The crimes were also allegedly committed on the territory of Afghanistan and by nationals of the Afghan state, as illustrated by the January request in which the Prosecutor mentions Haibatullah Akhundzada as the Taliban’s supreme leader and Abdul Hakim Haqqani as the Chief of the Supreme Court of the Islamic Emirate of Afghanistan. The conditions of jurisdiction are therefore, on a prima facie basis, fulfilled.
On the matter of admissibility, we must first discuss complementarity (article 17). The ICC may not deal with a case if it is being investigated or prosecuted by a competent state, unless that state is unwilling or unable to conduct the investigation or prosecution effectively. The ICC also cannot deal with a case if the State has decided not to prosecute the person concerned, unless that decision is motivated by a lack of will or a real inability on the part of the State to prosecute.
Lack of will (unwillingness) is characterized if the proceedings were or are being conducted, or if the national decision was taken, with the aim of exempting the person concerned from criminal liability, if an unjustified delay has been found in the proceedings or if there has not been or is not conducted independently or impartially in a manner incompatible with the intention to bring the person concerned to justice. Incapacity (inability) is established when, due to a total or substantial collapse of the national judicial system or its unavailability, the state is unable to persecute someone.
In Uganda, proceedings are underway for the Anti-Homosexuality Act of 2023, which introduces severe penalties for same-sex relationships, including life imprisonment and the death penalty for “aggravated homosexuality”. Petitions have been filed before the Constitutional Court to challenge the constitutionality of this law, notably by Pepe Onziema. In April 2024, the Constitutional Court decided to maintain most of the law. The appeal to the Supreme Court is ongoing, and for more details you can turn to our expert Pepe Onziema.
With regard to the condition of complementarity before the ICC, article 17 emphasizes the obligation to investigate and prosecute, which stresses the necessity for the proceedings to be of criminal nature. An appeal for unconstitutionality will probably not be considered as an ongoing proceeding within the meaning of section 17. In this sense, it would first be necessary to demonstrate that the State is not prepared to prosecute perpetrators of crimes against humanity by pursuing domestic courts on these grounds, which has not yet been done. However, if the head of state and members of parliament are the potential authors to be brought to justice, it is unlikely that this will happen due to the nature of their duties. This may constitute a lack of willingness, as the Prosecutor argued in the request for arrest warrants relating to the situation in Afghanistan.
With respect to Afghanistan, the Prosecutor, in his submission to the Pre-Trial Chamber in August 2022, recalls that after the Taliban took power in August 2021, the current authorities representing Afghanistan have neither the will nor the capacity to conduct genuine investigations or prosecutions, as evidenced by the release of thousands of prisoners and the proclamation of a general amnesty for all “political prisoners […] without any restriction or condition”.
The ICC repeatedly notes that no proper investigation is currently being conducted in Afghanistan (ICC, Preliminary Chamber II, Situation in the Republic of Afghanistan, 31 October 2022, §58). Although not required to do so in his request for warrants, the Prosecutor nevertheless reviewed the condition of complementarity in January and concluded that no internal proceedings are ongoing against Akhundzada and Haqqani, they exercise supreme authority over the Taliban and no institution of the Afghan de facto government has the authority or ability to investigate or prosecute them. We are waiting to see if the Chambers will accept these arguments.
Admissibility means complementarity, but it also means gravity (article 17). The case must be serious enough to be tried by the ICC, and rule 145 of the Rules of Procedure and Evidence serves as a guide. In Uganda, the scale of the attack must reach a certain threshold of severity. Based on surveys conducted by civil society organizations (including Sexual Minorities Uganda and Human Rights Awareness and Promotion Forum) and based on the testimony of our Ugandan colleagues, we have identified hundreds of reported human rights violations between 2018 and 2021, and we do not know the actual number of violations. SMUG has reported more than 1,000 cases of violence since last September. The nature of the attack includes arbitrary arrests, expulsions, insults, threats, police raids on LGBT shelters, police checks, very long police custody, physical assaults, physical and psychological violence and public humiliation. The impact on victims includes physical and psychological trauma, exclusion from the community and forced migration. The role and rank of perpetrators is particularly relevant because it is state-enacted legislation; therefore, a large proportion of crimes are committed or encouraged by state agents.
In Afghanistan, organizations reported that between 2022 and 2024, at least 98 LGBTQ+ people were publicly punished in 14 provinces, including stoning, flogging and imprisonment. There are credible reports of “kill lists” targeting LGBTQ+ individuals across the country, increasing fear and forcing concealment within the community. Since the mere fact of reporting these acts puts victims at risk, it is difficult to assess their true extent. The nature of the attack involves physical violence (beatings, sexual assaults and public flogging of people considered to be in violation of the gender norms imposed by the Taliban) and psychological abuse (Severe restrictions that have a major impact on the mental health of women, girls and LGBTI people). The impact on victims is extremely heavy, both physically and mentally, reinforced by the social isolation and marginalization of these populations. The role and rank of the perpetrators is crucial as persecution is sanctioned by the state, including the highest Taliban hierarchy, notably Supreme Leader Haibatullah Akhundzada.
Admissibility also includes the principle of Ne bis in idem. To date, there is no evidence that individuals responsible for crimes against LGBT people in Uganda or Afghanistan have been tried in another state.
Finally, the interest of justice is also a condition to take into account. The ICC has argued that not investigating potential perpetrators at the preliminary stage would be contrary to this interest. This had initially impeded the admissibility of the situation in Afghanistan, But this was remedied by the Appeals Chamber when it authorized the Prosecutor to open an investigation into crimes under the jurisdiction of the Court related to the situation in the Islamic Republic of Afghanistan. The Prosecutor is now explicitly mandated to investigate all potential perpetrators from the preliminary stage.
Jurisdiction and admissibility conditions seem to be all, prima facie, fulfilled. The ICC could be a legal avenue for atrocious crimes against the LGBTQ+ community in member states.
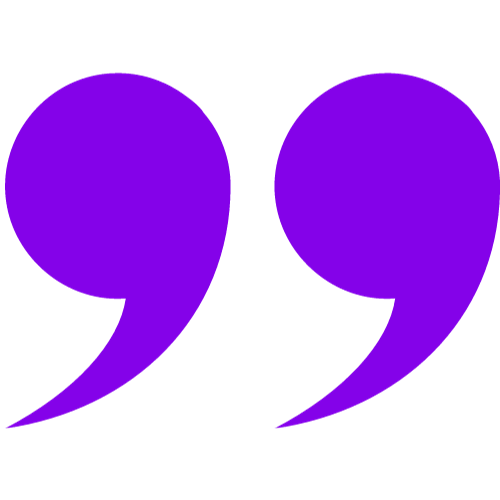

Français
La Cour pénale internationale peut-elle être saisie, concernant ses critères d’admissibilité et sa compétence, pour les situations en Ouganda et Afghanistan?
La Cour pénale internationale peut-elle être saisie en lien avec la criminalisation de l’homosexualité ?
La CPI a-t-elle compétence ratione personae, ratione loci et ratione temporis ? Comment le principe de complémentarité s’applique-t-il aux situations dans lesquelles les personnes LGBTQ+ sont victimes de crimes atroces ?
Merci beaucoup Etienne de me donner la parole, je suis heureuse d’ouvrir ce troisième panel. Je ne vais pas prédire l’avenir. L’objectif de ma présentation est de déterminer s’il existe ou non une voie juridique permettant à la CPI de traiter des situations et des affaires potentielles impliquant des crimes commis contre des minorités sexuelles et de genre. Je vais examiner toutes les conditions de compétence et de recevabilité pour les crimes commis sur les territoires de l’Ouganda et de l’Afghanistan et montrer dans quelle mesure elles sont remplies ou non. Il s’agit d’un moyen de conclure la deuxième partie relative au fond du droit afin de passer à celle portant sur la procédure.
En ce qui concerne la possibilité de soumettre à la CPI des affaires liées à des crimes présumés commis en Ouganda, cela semble prima facie possible au regard du droit applicable. En particulier, la CPI a déjà examiné une situation en Ouganda concernant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans le cadre d’un conflit entre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et les autorités nationales ougandaises depuis le 1er juillet 2002. Deux affaires ont déjà été jugées par la Cour : celles de Joseph Kony et Dominic Ongwen. Il existe donc déjà une base permettant à la CPI d’examiner la situation de l’Ouganda pour des crimes commis contre des personnes LGBT+.
Pour l’Afghanistan, nous avons un point d’appui avec la demande de mandats d’arrêt du Bureau du Procureur datée du 23 janvier de cette année, visant deux dirigeants talibans, ce qui montre la volonté du Procureur de se concentrer sur ce pays pour les crimes visant la communauté LGBT. Bien que les Chambres n’aient pas encore confirmé la requête, ce document constitue une bonne base pour examiner la compétence et la recevabilité des crimes allégués en Afghanistan. Même si la situation en Afghanistan et en Ouganda est politiquement sensible et que les crimes liés au genre sont difficiles à mettre en lumière dans ces deux pays en raison de leur nature conflictuelle, et même si nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, le simple fait que le Procureur de la CPI saisisse la Cour de ces questions reste un geste symbolique en faveur des droits universels et de la protection des minorités.
S’agissant de la compétence ratione temporis (article 11 du Statut de Rome), l’Ouganda a ratifié le Statut de Rome le 14 juin 2002. L’Afghanistan l’a ratifié le 10 février 2003. À ce jour, les deux pays sont toujours États parties à la Cour, la condition temporelle est donc remplie.
Concernant la compétence ratione materiae (article 5), comme nous l’avons vu précédemment, les crimes relevant de la compétence de la CPI incluent les crimes contre l’humanité de persécution.
Pour la compétence ratione loci/personae (article 12), les crimes ont été présumés commis sur le territoire ougandais et par des ressortissants de l’État ougandais. Les crimes ont également été présumés commis sur le territoire afghan et par des ressortissants de l’État afghan, comme l’illustre la requête de janvier dans laquelle le Procureur mentionne Haibatullah Akhundzada comme dirigeant suprême des Talibans et Abdul Hakim Haqqani comme président de la Cour suprême de l’Émirat islamique d’Afghanistan. Les conditions de compétence sont donc prima facie remplies.
En ce qui concerne la recevabilité, il faut d’abord discuter du principe de complémentarité (article 17). La CPI ne peut pas traiter une affaire si elle fait déjà l’objet d’une enquête ou de poursuites par un État compétent, à moins que cet État ne soit pas disposé ou ne soit pas en mesure de mener l’enquête ou les poursuites de manière effective. La CPI ne peut pas non plus traiter une affaire si l’État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, sauf si cette décision résulte d’un manque de volonté ou d’une réelle incapacité de l’État à poursuivre.
Le manque de volonté (unwillingness) est caractérisé si les procédures ont été ou sont menées, ou si la décision nationale a été prise, dans le but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale, si un retard injustifié est constaté dans les procédures ou si elles n’ont pas été ou ne sont pas menées de façon indépendante ou impartiale, d’une manière incompatible avec l’intention de traduire la personne concernée en justice.
L’incapacité (inability) est établie lorsqu’en raison d’un effondrement total ou substantiel du système judiciaire national ou de son indisponibilité, l’État est dans l’incapacité de poursuivre quelqu’un.
En Ouganda, des procédures sont en cours concernant la loi anti-homosexualité de 2023, qui introduit des sanctions sévères pour les relations entre personnes de même sexe, y compris la prison à vie et la peine de mort pour « homosexualité aggravée ». Des requêtes ont été déposées devant la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de cette loi, notamment par Pepe Onziema. En avril 2024, la Cour constitutionnelle a décidé de maintenir la majorité des dispositions de la loi. L’appel devant la Cour suprême est en cours, et pour plus de détails, vous pouvez vous tourner vers notre expert Pepe Onziema.
S’agissant de la condition de complémentarité devant la CPI, l’article 17 insiste sur l’obligation d’enquêter et de poursuivre, soulignant la nécessité que les procédures soient de nature pénale. Un recours en inconstitutionnalité ne sera probablement pas considéré comme une procédure en cours au sens de l’article 17.
En ce sens, il faudrait d’abord démontrer que l’État n’est pas disposé à poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité devant ses juridictions internes, ce qui n’a pas encore été fait. Toutefois, si le chef de l’État et les membres du Parlement sont les auteurs potentiels à poursuivre, il est peu probable que cela se produise en raison de la nature de leurs fonctions. Cela peut constituer un manque de volonté, comme l’a soutenu le Procureur dans la demande de mandats d’arrêt concernant la situation en Afghanistan.
En ce qui concerne l’Afghanistan, le Procureur, dans sa soumission à la Chambre préliminaire en août 2022, rappelle qu’après la prise de pouvoir par les Talibans en août 2021, les autorités actuelles représentant l’Afghanistan n’ont ni la volonté ni la capacité de mener de véritables enquêtes ou poursuites, comme en témoigne la libération de milliers de prisonniers et la proclamation d’une amnistie générale pour tous les « prisonniers politiques […] sans aucune restriction ni condition ».
La CPI note à plusieurs reprises qu’aucune enquête appropriée n’est actuellement menée en Afghanistan (CPI, Chambre préliminaire II, Situation en République d’Afghanistan, 31 octobre 2022, §58).
Bien qu’il n’y soit pas tenu dans sa demande de mandats, le Procureur a néanmoins examiné la condition de complémentarité en janvier et conclu qu’aucune procédure interne n’est en cours contre Akhundzada et Haqqani, qui exercent l’autorité suprême sur les Talibans, et qu’aucune institution du gouvernement de facto afghan n’a l’autorité ou la capacité de les enquêter ou de les poursuivre. Nous attendons de voir si les Chambres accepteront ces arguments.
La recevabilité implique la complémentarité, mais elle implique aussi la gravité (article 17). L’affaire doit être suffisamment grave pour être jugée par la CPI, et la règle 145 du Règlement de procédure et de preuve sert de guide.
En Ouganda, l’ampleur de l’attaque doit atteindre un certain seuil de gravité. Sur la base d’enquêtes menées par des organisations de la société civile (dont Sexual Minorities Uganda et Human Rights Awareness and Promotion Forum) et des témoignages de nos collègues ougandais, nous avons identifié des centaines de violations signalées des droits humains entre 2018 et 2021, sans connaître le nombre réel de violations.
SMUG a signalé plus de 1 000 cas de violences depuis septembre dernier. La nature de l’attaque comprend des arrestations arbitraires, des expulsions, des insultes, des menaces, des descentes de police dans des refuges LGBT, des contrôles policiers, des gardes à vue prolongées, des agressions physiques, des violences physiques et psychologiques ainsi que des humiliations publiques.
L’impact sur les victimes inclut des traumatismes physiques et psychologiques, l’exclusion de la communauté et la migration forcée. Le rôle et le rang des auteurs sont particulièrement pertinents car il s’agit d’une législation émanant de l’État ; une grande partie des crimes est donc commise ou encouragée par des agents étatiques.
En Afghanistan, des organisations ont signalé qu’entre 2022 et 2024, au moins 98 personnes LGBTQ+ ont été publiquement punies dans 14 provinces, y compris par lapidation, flagellation et emprisonnement. Des rapports crédibles font état de « listes de personnes à tuer » visant des individus LGBTQ+ dans tout le pays, ce qui accroît la peur et oblige la communauté à se cacher.
Comme le simple fait de signaler ces actes met les victimes en danger, il est difficile d’évaluer leur véritable ampleur.
La nature de l’attaque comprend la violence physique (passages à tabac, agressions sexuelles et flagellations publiques de personnes considérées comme violant les normes de genre imposées par les Talibans) et la violence psychologique (restrictions sévères ayant un impact majeur sur la santé mentale des femmes, des filles et des personnes LGBTI).
L’impact sur les victimes est extrêmement lourd, tant physiquement que psychologiquement, renforcé par l’isolement social et la marginalisation de ces populations.
Le rôle et le rang des auteurs sont cruciaux puisque la persécution est sanctionnée par l’État, y compris par la plus haute hiérarchie talibane, notamment le dirigeant suprême Haibatullah Akhundzada.
La recevabilité inclut également le principe de Ne bis in idem. À ce jour, rien n’indique que des individus responsables de crimes contre des personnes LGBT en Ouganda ou en Afghanistan aient été jugés dans un autre État.
Enfin, l’intérêt de la justice est aussi une condition à prendre en compte. La CPI a soutenu que ne pas enquêter sur des auteurs potentiels au stade préliminaire serait contraire à cet intérêt.
Cela avait initialement entravé la recevabilité de la situation en Afghanistan, mais cela a été corrigé par la Chambre d’appel lorsqu’elle a autorisé le Procureur à ouvrir une enquête sur des crimes relevant de la compétence de la Cour en lien avec la situation dans la République islamique d’Afghanistan.
Le Procureur est désormais explicitement mandaté pour enquêter sur tous les auteurs potentiels dès le stade préliminaire.
Les conditions de compétence et de recevabilité semblent donc toutes, prima facie, remplies. La CPI pourrait être une voie juridique pour juger les crimes d’atrocité commis contre la communauté LGBTQ+ dans les États parties.