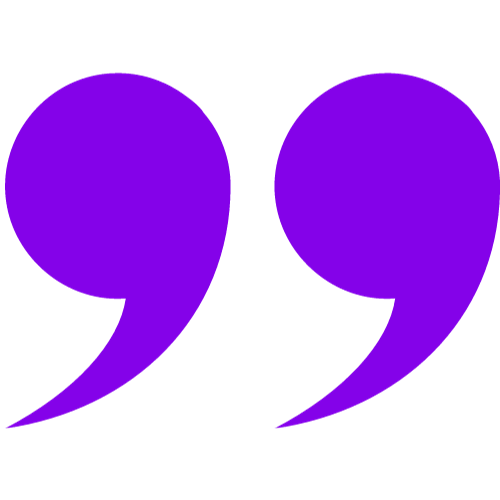Antoine Idier
Maître de conférences en science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales.Accueil »
Antoine Idier est maître de conférences en science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP, UMR 8183). Il est spécialisé dans l’histoire de l’homosexualité et des mouvements LGBTQI+, dans les théories minoritaires, ainsi que dans les relations entre art, culture et politique.
Antoine Idier a mené sa présentation sur la répression de l’homosexualité en France avant 1982.

English
State repression of homosexuality in France before 1982.
Good evening, everyone. Many thanks to Étienne Deshoulières and to the organizers of this conference for their kind invitation. It is a privilege to take part in these discussions and to listen to such powerful testimonies.
I am a lecturer at Sciences Po Saint-Germain-en-Laye and have recently published Réprimer et réparer, released by Textuel. This book traces the history of the repression of homosexuality in France and also addresses the current debates surrounding a reparations law—a law that, in my view, suffers from significant shortcomings and limitations. In that respect, tonight’s discussions are particularly relevant, as the use of international law and various legal instruments offers alternative pathways for redress.
I was asked to speak about the repression of homosexuality in France between 1942 and 1982. However, I would like to broaden that perspective. When we discuss the criminal repression of homosexuality in France, we typically focus on this 1942–1982 timeframe. But in my opinion, this narrow framing is a mistake—a mistake, notably, repeated in the reparations bill currently under debate in the French Parliament. Highlighting this error invites us to rethink what the repression of homosexuality has truly entailed in France and, more broadly, raises questions relevant to many other countries. Repression, both in France and elsewhere, has taken many different forms.
To fully understand this repression, we must go beyond the legal texts. It is essential to examine not only what is explicitly written in the law, but also institutional and judicial practices. Judges have applied general provisions of the penal code that do not specifically mention homosexuality but have been used to target homosexual behaviour. Police forces, too, have engaged in autonomous repression, often independently of the justice system—harassing LGBTQI+ individuals even in the absence of laws explicitly criminalizing homosexuality. Repressive practices extended beyond judges and police to include broader public institutions.
Although the 1942–1982 period is often emphasized in France, and not without reason, we must be cautious not to limit our focus to it. During these four decades, two articles of the penal code explicitly targeted homosexuality. First, a 1942 law—repealed only in 1982 after François Mitterrand’s election—set a higher age of sexual consent for homosexual relations. While individuals aged 13 or older could legally consent to heterosexual relations, the age of consent for homosexual acts was raised to 21. Anyone under 21 engaged in a homosexual relationship risked prosecution, and both partners could be convicted. Over 10,000 people were convicted under this law between 1942 and 1982—a law first implemented under the Vichy regime and deliberately retained in 1945 when republican legality was restored.
A second penal code article, in force from 1960 to 1980, increased penalties for public indecency when the acts involved homosexual behaviour—described in the law as « acts against nature. » Though the offence of public indecency dates back to the early 19th century, this specific provision allowed for heightened repression of homosexual acts in public spaces. It was also used against sex workers and others whose behaviour was deemed « offensive. »
However, we must not limit our understanding of repression to these two articles, or even to the 1940–1982 period. Homosexuality had already been prosecuted earlier through various penal provisions: public indecency, which has existed in the code since the 19th century; offences against public morality, which were used to censor activist publications like the Arcadie magazine in the 1950s; and « corruption of minors, » which criminalized certain sexual relations, particularly as the age of majority was then 21.
Additionally, administrative measures—often overlooked—played a role. The Paris police imposed fines on individuals labelled « transvestites, » a practice that persisted into the 1960s and 1970s. More broadly, one could speak of systemic police harassment. In the 1920s and 1930s, the police also employed internment, deportation, and expulsion measures against homosexual foreigners. They often viewed the law as inadequate and actively sought other tools to suppress homosexuality. For example, a 1907 Paris ordinance regulating carnival costumes was misused to target so-called « transvestites »—what we would now recognize as transgender individuals—whose attire was deemed inconsistent with their assigned gender at birth.
All of this underscores a key point: homosexuality was repressed through a regime of invisibility. French law long remained silent, not out of ignorance, but from a belief that explicitly legislating against homosexuality would grant it too much visibility and, in the eyes of lawmakers and jurists, promote homosexual behaviour. Thus, the repression was covert and deliberately obscured.
This invisibility has been tragically effective. The continued focus on the 1942–1982 period is itself a reflection of homophobic reasoning—it reinforces the narrative that repression was exceptional and confined, when in fact it was pervasive and ongoing. To restrict our understanding to that period is to participate, unwittingly, in the erasure of a broader history of repression.
We must also consider the geography of repression. As the presentation on Cameroon reminded us, today’s France was once a colonial empire, imposing repressive laws across its territories. In my book, I examine the case of Tunisia, where Article 230 of the penal code—still in force today—was introduced under French colonial rule in 1913. Thus, homosexuality was criminalized in Tunisia even before explicit repression existed in France itself. Moreover, colonial law was often more repressive than metropolitan law. In the colonies, administrative measures were deployed that had no equivalent in France. These historical realities raise critical questions for current debates on reparations: who are the rightful recipients of such reparations? Can they be imagined on a global scale?
Finally, these are not exclusively French issues. When we examine reparation efforts in other countries, we find similar patterns and challenges. In the United Kingdom, no fewer than four separate laws were required to establish a somewhat effective compensation system. Germany also had to implement multiple corrective measures. In Canada, many historians and sociologists pushed back in 2019 against official commemorations of the 50th anniversary of the supposed « partial decriminalization » of homosexuality in 1969. They argued that no real decriminalization had occurred, since repression continued under other legal forms and police actions—paralleling the French experience.
Thank you for your attention.
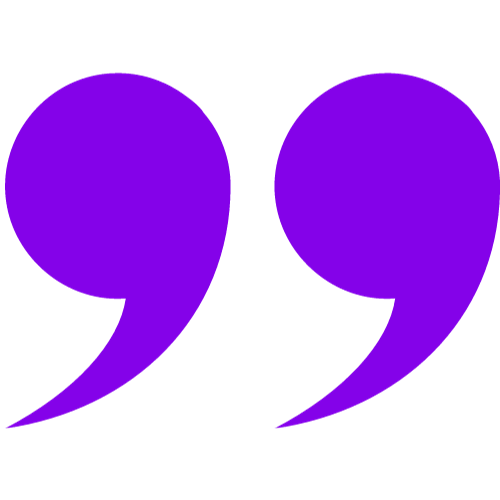

Français
La répression de l’homosexualité en France avant 1982.
Bonsoir à toutes et à tous, merci à Étienne Deshoulières et aux organisateurs de cette conférence de leur invitation. C’est évidemment passionnant de participer à ces discussions et d’écouter ces témoignages.
Je suis maître de conférences à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et je viens de publier Réprimer et réparer, aux éditions Textuel, un livre qui retrace l’histoire de la répression de l’homosexualité en France et qui revient en même temps sur les débats en cours relatifs à une loi de réparation, loi de réparation dont je critique un certain nombre de lacunes et d’insuffisances. À cet égard, les discussions de ce soir sont très intéressantes puisque l’utilisation du droit international, par différents outils juridiques, constitue une autre manière possible de faire réparation.
On m’a demandé de parler de la répression de l’homosexualité en France entre 1942 et 1982 et je vais me permettre de déplacer un tout petit peu le regard. Précisément : lorsqu’on évoque la répression pénale de l’homosexualité en France, on se concentre habituellement sur cette période, 1942-1982, et on se limite habituellement à cette période, ce qui, à mon sens, est une erreur. C’est une erreur, notamment, que reproduit la proposition de loi de réparation en débat au Parlement français depuis un an et demi, avec un certain nombre de conséquences. Mettre en avant cette erreur permet à la fois de s’interroger sur ce qu’a vraiment été la répression de l’homosexualité en France, mais aussi de poser une question plus générale qui concerne un certain nombre de pays au-delà de la France, en prêtant attention au fait que la répression de l’homosexualité en France comme ailleurs prend de multiples formes.
Appréhender cette répression de l’homosexualité dans son entièreté nous oblige à ne pas regarder seulement la loi, à ne pas regarder seulement ce qui est écrit explicitement, directement et ouvertement dans la loi ; cela demande d’aller regarder du côté des pratiques plutôt que du côté des textes. Pratiques des juges qui utilisent des articles généraux du code pénal ne visant pas directement et explicitement l’homosexualité, mais qui sont utilisés pour viser un certain nombre de comportements homosexuels. Pratiques des policiers qui exercent une répression autonome d’autres institutions, notamment autonome de la justice pénale : la police a contribué (et contribue encore, dans certains pays) au harcèlement quotidien qu’ont vécu les personnes LGBTQI+, même en l’absence de texte qui criminalisent l’homosexualité. Pratiques des juges, des polices, mais aussi d’un ensemble d’institutions publiques.
Si, en France, on se concentre souvent sur la période 1942-1982, ce n’est pas non plus sans raisons : sur ces quarante années, deux articles du code pénal ont explicitement visé l’homosexualité. Une loi introduite en 1942, supprimée en 1982 à la suite de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République, créait un âge spécifique du consentement sexuel pour les relations homosexuelles. En 1942, tout individu de plus de 13 ans est présumé en capacité de donner son consentement à une relation hétérosexuelle, et cet âge est porté à 21 ans pour les relations homosexuelles : toute personne de moins de 21 ans impliquée dans une relation homosexuelle tombe sous le coup de la loi et les deux partenaires peuvent être condamnés. Dix mille personnes ont été condamnées sur le fondement de cette loi entre 1942-1982, une loi mise en œuvre par le régime de Vichy et maintenue, par un acte volontaire, en 1945, lors du rétablissement de la légalité républicaine.
Un second article du code pénal, en vigueur entre 1960 et 1980, prévoyait une aggravation du délit d’outrage public à la pudeur, qui permettait de réprimer un certain nombre de comportements sexuels au motif qu’ils présentaient un caractère public, et que cette publicité constituait un outrage à la pudeur. L’outrage public à la pudeur est apparu au début du dix-neuvième siècle, avec le nouveau code pénal. Il a été utilisé depuis le début du dix-neuvième siècle contre les relations homosexuelles, mais aussi contre les travailleurs et travailleuses du sexe, contre un certain nombre de comportements jugés offensants. Entre 1960 et 1980, la peine applicable est doublée lorsque cet outrage constitue un rapport homosexuel (la loi disait acte « contre nature »).
Mais, je l’ai dit, il ne faut pas se limiter à ces deux articles du code pénal pour appréhender la répression de l’homosexualité. Il ne faut pas non plus se limiter à la période 1940-1982, puisque l’homosexualité était déjà poursuivie auparavant, à travers une diversité de dispositifs pénaux. C’est l’outrage public à la pudeur, qui existait dans le code pénal depuis le début du 19ᵉ siècle. C’est l’outrage aux bonnes mœurs, qui a été utilisé pour poursuivre des publications militantes, par exemple la revue homophile Arcadie dans les années 1950. C’est encore l’excitation de mineurs à la débauche qui permettait d’incriminer des relations sexuelles impliquant des mineurs, étant donné que l’âge de la majorité est alors de 21 ans.
Ce sont aussi des contraventions mises en œuvre par la police parisienne contre ceux et celles qui étaient nommés des « travestis » – la pratique avait encore cours dans les années 1960 et 1970. C’est, plus largement, un ensemble d’activités policières, on pourrait plutôt dire un harcèlement policier. Ce sont des mesures administratives, l’internement, la déportation, des expulsions d’étrangers homosexuels, comme je l’ai montré, dans les années 1920-1930. La police a déployé une doctrine selon laquelle la loi était insuffisante pour combattre l’homosexualité ; il revenait donc à la police de trouver d’autres moyens que ceux prévus par la loi pour lutter contre l’homosexualité. La police assumait même de détourner des outils légaux et réglementaires : il existait ainsi à Paris une ordonnance de 1907 qui permettait d’interdire le travestissement, ordonnance prise pour réguler le carnaval et la pratique du déguisement ; la police reconnaissait détourner ce texte et l’utiliser contre des personnes dites « travesties » – on dirait aujourd’hui aujourd’hui des personnes transgenres – dont l’habillement est jugé d’un genre qui n’est pas celui qui leur a été assigné à la naissance.
Tout cela est très important. Parce que l’homosexualité a été prise dans un régime d’invisibilité, marqué par la volonté de ne pas publiciser la répression. Si la loi française est longtemps restée silencieuse, c’était en raison de l’idée suivante : inscrire l’homosexualité dans la loi, par l’inscription de la répression, ferait plus de mal que de bien, en rendant visible l’homosexualité et, selon le législateur et des juristes, en encourageant les pratiques homosexuelles. D’où une répression volontairement laissée dans l’ombre, une répression volontairement souterraine.
D’où un étonnant succès de la raison homophobe, si cette invisibilité de la répression perdure, si cette invisibilité a tellement bien fonctionné que l’on se concentre seulement sur la période 1942-1982. S’intéresser à la période 1942-1982, c’est finalement reprendre le cadrage homophobe en renouvelant cette invisibilité de la répression.
Il faut également réfléchir à la géographie, à la territorialité de la répression. Comme l’intervention au sujet du Cameroun l’a rappelé, la France d’aujourd’hui n’est pas la France d’hier : la France a été un empire colonial et a mis en place des législations et des outils réprimant l’homosexualité dans un certain nombre de territoires coloniaux. Dans mon livre, je reviens sur l’exemple de la Tunisie : l’article 230 du code pénal, toujours appliqué aujourd’hui, est une invention française, qui remonte au protectorat et à l’écriture d’un nouveau code pénal en 1913. L’homosexualité est explicitement réprimé sur le territoire tunisien avant même de l’être en France. En outre, le droit colonial est un droit dérogatoire et des mesures administratives répressives ont pu être déployées dans les territoires coloniaux, alors même que ces mesures n’existaient pas en France. Ce qui soulève une autre question aujourd’hui, si on débat de la réparation au sens large : qui sont les sujets de cette réparation ? À qui s’adresse la réparation ? Comment l’appréhender à une échelle mondiale ?
Enfin, ces questions ne sont pas du tout des questions spécifiquement françaises. Quand on étudie les expériences et les débats qui ont lieu à l’étranger sur la réparation de la répression de l’homosexualité, on constate que ces problèmes que j’ai soulevés se retrouvent dans des formes très similaires. Les différents dispositifs de réparation qui ont été mis en œuvre à l’étranger ont dû être amendés. Au Royaume-Uni, il a fallu jusqu’à quatre lois pour réussir à obtenir un dispositif de réparation à peu près satisfaisant. L’Allemagne a dû adopter plusieurs dispositifs. Je pense encore au Canada, où un certain nombre de collègues historiens et sociologues s’étaient insurgés en 2019, contre les célébrations du cinquantième année de la dépénalisation partielle de l’homosexualité en 1969. Ces chercheurs affirmaient alors : non, il n’y a pas eu de dépénalisation, même partielle, de l’homosexualité en 1969 car, en dépit de la suppression d’une répression explicite dans le code pénal, la répression a continué sous d’autres formes, par l’activité policière, par l’utilisation d’autres articles du code pénal – ce qui est comparable à la situation française.
Merci de votre attention.